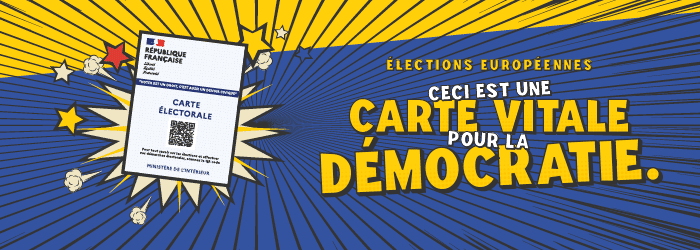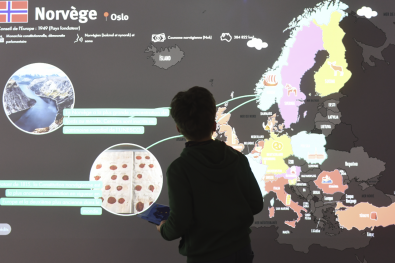J’ai passé des centaines d’heures à vagabonder dans les trams strasbourgeois, laissant l’empreinte de mes reins au creux de fauteuils défraîchis et celles de mes fesses sur des strapontins grinçants. Debout, assis, dans un équilibre précaire, tentant de m’agripper à une barre tiède ou une manche timide lorsque la situation devenait trop critique, traversant des odeurs insistantes et lourdes. La sueur, l’haleine chargée de vodka, le déodorant à l’eucalyptus, le souffle d’un kebab comatant dans un cocon d’aluminium scintillant, le Chanel numéro 5 embaumant un cou désirable, l’après-rasage musqué d’un mâle à la peau tailladée par le mouvement matinal et trop approximatif d’un rasoir déterminé, du vomi multicolore qui colle au sol comme le testament d’un artiste anonyme ayant le mal de transport.
Bansky, peignant avec ses tripes entre Langstross Grand’Rue et Place Broglie.
Les peaux se touchent parfois avec pudeur. Les regards se croisent ou s’évitent entre deux textos, sur des téléphones greffés à des ongles vernis, noirs, rouges, violets, sculptés par des incisives tranchantes. Nous nous croisons sans vraiment nous connaître dans des wagons bondés, nous jaugeant, nous jugeant en une fraction de secondes sur une attitude, un vêtement, une expression qui transperce l’anonymat d’un voyage trop long ou trop court, lorsqu’une rencontre illumine la routine d’une journée identique à celle d’hier, déjà identique à celle d’avant-hier. Chaque détail est amplifié dans la proximité des corps. La silhouette saucissonnée comme un gigot dans un jean slim sadomasochiste. La barbe rousse d’un Père Noël en Doc Martens, tatoué d’une tête-de-mort sur l’avant-bras. Un t-shirt trop transparent dévoilant l’intimité d’une poitrine endormie. La morve d’un moineau en salopette qui dégouline sur son menton naïf et sa mère qui fixe ses pieds comme s’ils allaient lui annoncer la vérité sur ce bordel organisé qu’on appelle la vie. Les cils interminables d’une lycéenne maquillée à la truelle. Le regard perdu d’un vieillard qui semble ne plus trop bien savoir ce qu’il fait là. La voix nasillarde d’un livreur Deliveroo agacé par la mauvaise blague de son GPS déboussolé.
Les plus entreprenants jettent leur dévolu sur une paire de fossettes dont ils ne veulent plus se séparer, comme un coup de foudre entre deux contrôleurs de la CTS. Une inconnue qui descendra à la prochaine station, les laissant figés sur place, frustrés de ne pas connaître son nom et priant chaque jour pour la recroiser à la même heure, sur la même ligne.
Emma ? Fanny ? Mathilde ? Ils ne sauront jamais, mais garderont à l’esprit l’image de ce moment précis où elle tourna la tête sur le trottoir pour un dernier sourire qui en dit long.
Les plus timides s’isolent dans leurs pensées ou dans la mélodie d’une musique faisant office de compagnon de route, un monologue intérieur qui apaise, permettant de s’échapper d’une réalité trop abrupte, de déceptions trop fréquentes ou au contraire qui ravive les flammes d’une vie surprenante, désinvolte, où Alice aux pays des merveilles se cache à chaque coin de rue, assise à une terrasse, trinquant avec un lapin éméché.
Je ne peux pas concevoir de traverser ma ville chaque jour, et plus largement ma vie, dans un vaisseau spatial tanguant, sans la présence d’un riff de guitare, d’une basse puissante ou du chuchotement d’une voix éreintée dans ce casque qui borde mes oreilles usées. Parce que comme disait Nietzsche, la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil.
Mes souvenirs les plus poignants, les plus destructeurs ou les plus enivrants sont associés à une chanson, un refrain, un morceau de piano. Ils font partie de ma vie et sont les mémoires d’une existence saccadée que nous cherchons à maîtriser pour mieux nous en accommoder, même si au final, le destin fait ce qu’il veut, imprévisible sale gosse que nous avons tout de même envie de prendre dans nos bras.
À vingt-deux ans, je pleurais la douleur d’une rupture et de l’absence d’un premier amour sur l’album Hvarf de Sigur Ros. L’Islande entre deux mouchoirs en papier trempés, entre deux morceaux de choucroute. Le xylophone en guise d’antidépresseurs. Ce fut durant le concert de Muse en 2003, au Rhénus, que je pus ressentir la ferveur de Strasbourgeois déchaînés sur le solo magistral de Matthew Bellamy durant New born. Une renaissance, c’est le cas de le dire. La peau dégoulinante. Les pogos surexcités. Un slam sur le dos, les deux bras écartés, priant pour que la foule ne s’écarte pas au dernier moment afin de laisser place à la froideur du béton jonché de gobelets en plastique. Shams comprendra ce passage mieux que personne.
À six ans, je tentais de fredonner Supercalifragilisticexpialidocious seul dans ma chambre, écoutant en boucle la bande originale de Mary Poppins, perturbé par la beauté de Julie Andrews.
Je peux l’avouer aujourd’hui : je crois bien que j’étais terriblement amoureux d’elle, simulant notre baiser langoureux avec les lèvres de mon ours en peluche Wallaceq qui est toujours en psychothérapie. Il y a aussi des morceaux inaudibles désormais, ravivant trop de douleur, de souvenirs, des épines dans une chair encore meurtrie comme Time de Pink Floyd, synonyme de la cérémonie d’enterrement de l’un de mes meilleurs amis ou Mistral Gagnant, l’album magistral de Renaud qui me crève le cœur en repensant aux divorces de mes parents durant un mois de juillet caniculaire.
La musique fut mon exutoire dans des moments de doute, cherchant des conseils dans les paroles de Radiohead, de Nick Cave ou de PJ Harvey, me rendant plus fort et me permettant de mieux comprendre des choses que la raison seule ne pouvait pas m’enseigner.
Alain Bashung restera celui qui me conforta dans l’idée que la mélancolie est un grand terrain de nulle part avec de belles poignées d’argent, la lunette d’un microscope et tous ces petits êtres qui courent. Léo Ferré m’enseigna l’humilité en décrivant mieux que quiconque la fatalité de la vie dans Avec le Temps, là où tout va, tout s’en va, l’autre qu’on adorait, qu’on cherchait sous la pluie, l’autre qu’on devinait au détour d’un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le fard, d’un serment maquillé qui s’en va faire sa nuit.
Merci à Mano Solo de m’avoir transmis la beauté de ces petits moments que j’ai tendance à oublier, happé par des obligations parfois superficielles. La regarder dormir et respirer, nous voir vieillir et prendre des rides, parce qu’on s’en fout de rouiller un peu, on va rester là quand même alors autant danser sous la pluie, se tromper, ça risque d’être long, mais nous n’avons rien de mieux à faire.
Merci à David Bowie d’avoir transformé le quai des Bateliers en planète Mars lors de mes balades solitaires nocturnes avec Tom, ce major fantomatique muet. Je pouvais entendre la tour de contrôle débuter un compte à rebours avant le lever du soleil. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, décollage. Les étoiles étaient différentes ces soirs-là, je flottais dans la rue, loin au-dessus du monde, loin au-dessus de la lune alors que mon corps lui, se traînait comme une boite de conserve.
Merci à ma grand-mère pour ces berceuses les soirs d’orages, lorsque les volets claquaient trop fort dans ce petit appartement de la rue des Enfants, que je cherchais une deuxième souffle, caché sous une couette trop épaisse.
Merci à Brice et son violoncelle au pied de la cathédrale.
Merci à Puccini de me donner la chair de poule chaque matin à l’arrêt de tram A de la place de l’Étoile lorsque Mario pleure son exécution imminente dans Tosca.
Et les étoiles brillaient, et la terre embaumait.
La porte du jardin grinçait, et un pas effleurait le sable.
Elle entrait, parfumée, me tombait dans les bras.
Ô doux baiser ! Ô caresses langoureuses !
Tandis que je tremblais, elle libérait ses belles formes de leurs voiles,
Il s’est évanoui pour toujours, mon rêve d’amour.
L’heure s’est envolée, et je meurs désespérée ! Et je n’ai jamais autant aimé la vie !
Merci à toutes ces mélodies du bonheur que je n’oublierai jamais et à toutes celles à venir. Je ne pourrais que survivre sans vous, me raclant la gorge nerveusement, cherchant un phare au milieu de la foule, noyant la routine dans un sifflement pathétique. Alors, si vous rencontrez un ange écoutant de la musique trop fort dans le bus, les larmes aux yeux ou le sourire aux lèvres, ne cherchez pas ses ailes, approchez-vous, il se pourrait bien que ça soit moi.