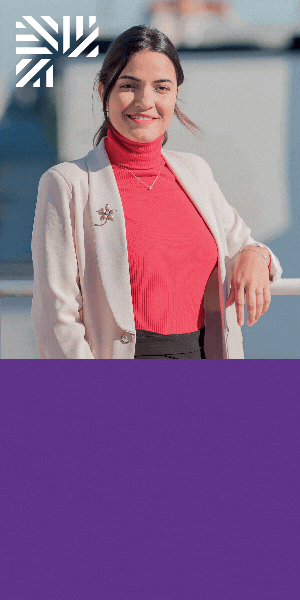Il a l’habitude d’aller dans ce bureau de tabac chaque après-midi, rue du 22 Novembre, en espérant qu’il se passera quelque chose de miraculeux sur le chemin du retour. La prophétie de la Française des Jeux.
Le monologue de celui qui compte sur un coup de pouce du destin en grattant un carnet de Bingo entre deux cafés froids.
« Cette-fois, ça passera » se dit-il en regardant le ciel, des cernes jusqu’aux tibias, l’ongle noirci par une dizaine de tentatives infructueuses et les tickets qui virevoltent comme des papillons blessés avant de s’écraser dans un cendrier dégueulant de mégots.
L’un deux est marqué de rouge à lèvres, comme les Vogue que fume Clara, l’une des femmes qu’il côtoya dans des draps tachés durant une folle semaine, lorsque les dieux des champs de courses étaient de son côté. Sept jours plus tard, sa chemise Calvin Klein pue la sueur et sa vie est un champ de bataille, avec en face, une dizaine de créanciers aux dents dorées, avides de mâchoires cassées et de battes de base-ball qui brisent les genoux comme de la porcelaine. Si ce foutu cheval n’avait pas eu un coup de sang à deux-cents mètres de l’arrivée, il serait en Toscane, à siroter un Spritz et à sucer des olives derrière une paire de Prada.
Il n’aura pas droit à une autre chance. Le Grec lui a bien fait comprendre que si dans quarante-huit heures l’argent n’est pas sur sa table basse, il y aura des os broyés incrustés au mur et une flaque de sang sur son parquet fraîchement lustré.
Ça, c’était il y a 72 heures. Ils sont déjà à ses trousses.
L’odeur de la peur commence à imprégner sa peau. Il transpire anormalement et se retourne toutes les trente secondes en jouant avec sa fausse Rolex, pour vérifier qu’il n’est pas suivi par une silhouette familière, dans le style de celles que même la mort évite.
Il lui reste une centaine d’euros en poche qu’il a extirpé à sa mère, prétextant une panne de voiture alors qu’il n’a plus le permis depuis presque trois ans.
Le mensonge est devenu une habitude.
Avec sa femme, avec son fils, avec lui-même, se trouvant toujours des excuses pour ne pas s’avouer qu’il a touché le fond et qu’il ne sait pas nager. Rester ici et se faire tabasser ou partir et ne plus jamais revenir. Tirer un trait sur sa vie à Strasbourg, sur la came, les plans bidon et les entourloupes qui conduisent au fond d’une cellule de onze mètres carrés à Elsau.
Les promenades – Les parloirs – Les cris – Les yoyos qui dansent entre les barreaux des fenêtres. Il a déjà donné. Il cède volontiers sa place à d’autres, aux Balkany et compagnie.
À la télé du troquet d’en face, une meute de hyènes tachetées traque un faon blessé à la patte droite. Bambi boîte sur quelques mètres puis se fige, humant les charognards volant en cercle au-dessus de lui. Un vent incandescent souffle sur les brins d’herbes desséchées. Les criquets brisent le silence de la savane par leurs chants réguliers. Ses oreilles tournoient comme des satellites à la recherche d’un signal divin, d’un indice, d’une ouverture vers autre chose que la fin. Le commentateur de la BBC décrit la scène de sa voix grave. Le calme avant la boucherie, une musique angoissante en arrière-fond.
« Par cette chaleur, les hyènes s’épuisent rapidement. Elles doivent donc renverser rapidement le faon. Un combat inégal s’enclenche. L’une d’entre-elles détourne son attention de face pendant que les autres attaquent par derrière et de flanc. L’animal tombe sur le côté en gémissant, le regard vide, les crocs déchirant sa chair avec violence. Il ne faudra que quelques minutes pour l’achever et quelques heures pour que sa carcasse soit nettoyée par les vautours ».
Il faut qu’il se cache s’il ne veut pas finir dans un reportage de la BBC lui aussi. Il lui reste l’Odyssée, pour réfléchir jusqu’à la dernière séance de 22h10. Après, il sera livré en pâture, à l’heure où les bienheureux jouissent puis s’endorment, leur femme dans les bras et où les arnaqueurs supplient à genoux de ne pas finir dans le Rhin ou dans un trou de la forêt du ROHRSCHOLLEN.
Le temps passe trop vite quand la faucheuse est déterminée. La nuit s’empare de la ville au contact des lampadaires lumineux qui délimitent des chemins de croix le long des pavés.
Il tend un billet à la caissière qui lui demande quel film il souhaite voir.
« Peu importe. Celui qui dure le plus longtemps. S’il y a un film qui ne se termine jamais, je prends ».
Ils sont deux dans la salle. Lui et un vieillard amaigri qui passera toute la séance à somnoler. L’écran s’illumine. Les hauts-parleurs crépitent. Dead Man de Jim Jarmusch, un réalisateur dont il n’a jamais entendu parler.
Son truc, c’est les films d’actions, les grosses bagnoles, Vin Diesel, des courses poursuites entre la mafia et les flics, avec au milieu, un mec paumé amoureux d’une blonde à qui il promet de se repentir. Il peut s’identifier au personnage et bomber le torse en imitant le bruit d’une Toyota tunée tout en ingurgitant une gorgée de Jack Daniel’s.
Johnny Depp apparaît au milieu d’une image en noir et blanc pendant que des sous-titres s’installent au bas de l’écran. C’est l’histoire de William Blake qui prend le train pour y exercer le métier de comptable et qui se retrouve accusé à tort d’un double meurtre dans la lugubre ville de Machine. Une balle logée près du cœur et accompagné de Nobody, William s’engage dans un périple à travers l’Ouest sauvage. Un western hallucinogène, mélancolique, poétique, sans histoire, sans bravoure, sans vengeance ni morale.
L’histoire l’endort malgré la guitare électrique de Neil Young en guise de bande-son.
Il sort un sachet de sa chaussette blanche à rayures vertes et jaunes puis trace une ligne droite de poussière d’étoiles filantes sur l’accoudoir du fauteuil. Un Solitaire roulé en cône fait office de paille. Son pouce droit bouche la narine du même côté, pendant qu’avec l’autre, il sniffe d’un coup sec quatre centimètres de neige. De la poudreuse. Un remonte-pente à 65 euros le gramme. Il s’agite, enlevant ses chaussures et regarde nerveusement son téléphone jusqu’à cette réplique qui raisonnera en boucle dans sa tête jusqu’à la fin.
Some are born to sweet delight / Some are born to the endless night
Certains naissent pour le délice exquis / Certains pour la nuit infinie.
Le cinéma ferme ses portes. Avant de sortir, il en profite pour vider sa vessie dans un pissoir qui sent l’eau de javel et pour se regarder dans la glace.
« Certains naissent pour le délice exquis » qu’il répète à son reflet jusqu’à lancer un coup de poing furtif dans le mur.
Les fenêtres du bâtiment d’à côté clignotent, tentant de lui transmettre un message en morse.
La rue est presque déserte. Le tram bondé de la dernière chance rappelle que Strasbourg n’est pas une ville fantôme ou Milla Jovovich shoote des morts-vivants au fusil à pompe.
Résident Evil.
Le zombie, c’est lui et il n’a plus la possibilité de se cacher derrière les autres paumés de la Rue du Faubourg National, à siroter des 8°6 et à revendre des barrettes de shit qu’il planque dans son slip.
Les amis ne sont jamais là quand il a besoin d’eux, ce qui lui fait dire à haute voix que ce ne sont pas des amis mais des compagnons qu’il tolère afin de se sentir moins seul. Mais ce soir il est seul, comme un fantôme que personne ne peut voir dans une nuit infinie qui ne fait que commencer.