Cela fait plus d’un mois que je n’ai pas remis les pieds à proximité de ce bar dans lequel j’ai investi presque toute ma vie. Une grille métallique imposante encercle le bâtiment comme un château-fort muet qui n’est depuis longtemps plus en proie aux attaques de clients armés de soif. C’est la boule au ventre que j’enfonce la clé dans la serrure de la ceinture de chasteté de la fête, empêchant les âmes libres de se mélanger, de se toucher, de jouir verbalement et visuellement autour d’une pinte ou d’un Spritz surdosé.
Rien n’a bougé. Cette odeur si particulière, qui imprègne les murs, est omniprésente. Le houblon. Les bouteilles alignées au garde-à-vous comme les soldats d’une réjouissance nécessaire après une journée de boulot asphyxiante. Les tables en bois usées par des parties de coudes insolentes jusqu’au petit matin. Quelques sous-bocks en PLS sur le comptoir, contemplant des tireuses déprimées qui ne tirent plus que des balles d’amertume dans mon cœur écœuré.
Tout est trop calme. Tout est trop ordonné et trop sage.
Comme si l’hiver prenait le printemps en otage, comme si Strasbourg avait des airs de Pyongyang, conditionnée par l’interdit et par un virus qui nous laisse en sursis, une épée de Jean Castex au-dessus de la tête, une boîte de Xanax presque vide sur nos tables de chevet, entre une capote périmée et une édition cornée de « Souvenirs d’un pas-grand-chose » de Bukowski.
Nous n’étions effectivement que des miettes de quelque chose, mais des miettes vivantes, et non pas des traces amputées de la présence des autres, avalant une nourriture dans l’isolement le plus abject, racontant nos pêchés à des pavés silencieux qui s’en tapent royalement de nos joies, de nos peines et de nos doutes.
Il y a deux ans, jour pour jour, nous débutions notre service, Marion, Nathan et moi, dégustant un repas en aparté, avant que les premiers clients pointent le bout de leur nez. Marion apprenait qu’elle était enceinte et se caressait le ventre avec tendresse, pendant que Nathan, d’une humeur amoureuse, me décrivait les yeux de sa nouvelle conquête. « Cette fille a les yeux tellement bleus que son visage est un petit de coin de Sicile dans lequel je pique-nique avec délice ».
Le soleil caressait nos peaux encore blanches suite à un hiver rugueux où la neige avait transformé les rues en de vastes champs de coton ivoire et où la cathédrale avait des airs de Kilimandjaro. En t-shirts et en bermudas, la vie reprenait peu à peu son cours, après une hibernation forcée au chaud, à se goinfrer de raclettes, de tartiflettes, de repas copieux et réconfortants où le gras nous tendait les bras et embrassait nos bedaines naissantes. Les premiers touristes s’installaient et échangeaient en allemand, anglais ou chinois, chantant le début des vacances de Pâques, se laissant tenter par une bière fruitée ou corsée, un burger saignant ou une planchette de fromages qui ferait même saliver le diable.
Le tablier fermement accroché à la taille, un ballet harmonieux entre les tables débutaient. Progressivement, l’espace prenait vie. Les mollets timides se risquaient à se montrer entreprenant au rythme des plateaux chargés qui déversaient leurs friandises à une cadence effrénée. Les clopes tournaient dans les bouches charnues et petit à petit, les faces pâles prenaient la couleur de l’insouciance pendant que les corps trop rigides, trop droits, s’enfonçaient dans des chaises aux allures de transats.
Les regards se cherchaient derrière les lunettes de soleil. Un copain croisait la route d’un autre et s’arrêtait le temps d’une Licorne compacte, mais très souvent tombait dans une embuscade jusqu’à la fermeture, la bouche pâteuse et les tickets de carte bleu plein le portefeuille. Parce qu’en ces temps bénis, tout pouvait encore s’improviser, la surprise prenait son pied et des aventures non prévues, non planifiées, s’écrivaient sur les pages vierges du livre de l’inconnu dès l’apéritif.
L’heure des semblants, des tricheries et des personnages sonnait. On arrivait à se comprendre, parce que les pensées et les mots pouvaient fasciner, même si, pour finir, nous savions tous que tout cela n’était qu’une fuite les yeux grands ouverts, mais une fugue nécessaire pour supporter tout le reste. La merde, on y était, mais on y était ensemble, regroupés au beau milieu de l’énorme cuvette des chiottes de la vie qu’on appelle un bistrot, un troquet, un bar, un pub, une taverne, un confessionnal, un exutoire, un cafeton, une buvette, un rade, ce lieu si particulier sans jugement où les pauvres côtoient les riches. L’ivresse avec des proches ou des inconnus était agréable, faisant disparaître les évidences, les certitudes lorsque nous trinquions, parce que peut-être en réussissant à se tenir assez longtemps loin des évidences, on évitait d’en devenir une soi-même.
Il y avait cette cliente fidèle, professeur d’italien, rousse au long nez pointu qui portait des robes fleuries et des chaussures noires vernies. Des jambes interminables et fières. On aurait dit un serpent. Elle gardait toujours une table de libre au soleil de façon à observer les passants, son passe-temps favori. Flâner devenait une activité à temps plein, une pause et non pas un ennui forcé, un jeu pour adulte dont on ne se lasse jamais.
C’était le temps des aisselles impertinentes, de la sueur, une récréation sans fin où tout devenait possible : devenir avocat, boulanger, artiste ou quelque chose d’approchant. Se marier, avoir des enfants ou n’être qu’un plan cul. Faire des trucs, des trucs simples, partir à l’autre bout du monde sur un coup de tête ou poser une couverture au milieu d’un parc avant la tempête.
Les fantômes ne se cachaient pas derrière un drap en forme de masque, où l’on pouvait se rouler des pelles et se dire je t’aime en titubant jusqu’à ce que la lune nous borde maternellement.
C’était le temps où l’on finissait avec une moustache de chocolat jusqu’au front avec mon filleul et mon neveu, après avoir cherchés les œufs planqués dans le jardin de mon cousin.
On pouvait s’accroupir sur les quais de jour comme de nuit, l’esprit troublé, ou tremper les pieds dans l’eau, pour inspirer la liberté à pleins poumons et expirer toutes nos frustrations, pour se défouler autour d’un verre de Picon en écoutant la chanson lasse du temps qui passe.
C’était le temps où Strasbourg nous appartenait.





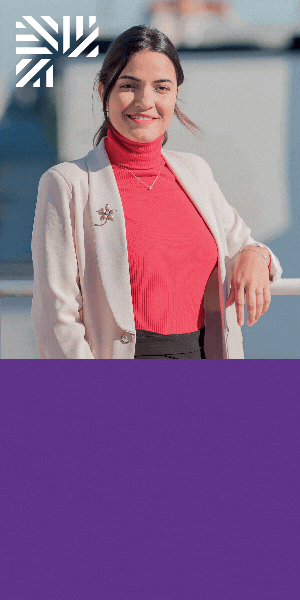









SVP, dites-moi que le temps où » tout pouvait encore s’improviser » reviendra…,
Bonjour Jane,
Le temps des cerisiers et des copains reviendra, j’en suis persuadé!
Monsieur Z, Damienz ou cher auteur,
Je lis chacun de vos articles avec délectation. Vous maniez les mots et la langue française avec l’aisance d’un jongleur, faisant voler haut les images et métaphores qui nous plongent dans les moments décrits comme si nous les vivions.
Merci à vous pour ces parenthèses poétiques, ces photographies souvent nostalgiques de temps révolus, mais qui, je l’espère, reviendront.
Bonjour Nadia,
Merci pour ce retour gratifiant qui me pousse encore davantage à transmettre les images qui défilent dans ma tête.