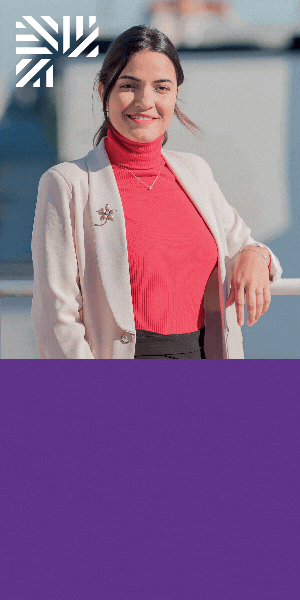Pokaa réalise une série de portraits de professionnels. L’objectif de la démarche : donner la parole à des travailleurs et des travailleuses du quotidien qui œuvrent tous les jours pour l’alimentation, l’éducation, les secours et d’autres domaines incontournables pour la société. Ces personnes nous ont raconté leur vie, leurs difficultés, la vision qu’elles ont de l’évolution de leur métier…
>> Lire ou relire l’épisode 1 : De comptable à agriculteur bio : avec Mathieu, Alsacien amoureux de sa terre
Épisode 2 : Caroline, institutrice depuis 33 ans, se livre dans cet article. De sa passion pour l’école qui l’a ouverte sur le monde quand elle était enfant, à sa retraite qui l’inquiète, en passant par les adaptations à la crise sanitaire, son récit pointe du doigt des problématiques qu’elle rencontre au quotidien.
Caroline (son prénom a été modifié), 54 ans, est institutrice depuis 33 ans. Elle a accepté de témoigner, mais désire protéger son identité sous peine d’avoir « des problèmes avec le rectorat. » Elle a enseigné dans plusieurs départements, d’abord en tant que remplaçante, puis pour des classes bilingues, ensuite dans des écoles classiques et maintenant dans une école rep+ à Strasbourg. Cette rentrée 2020, accompagnée de mesures sanitaires, est d’après elle, moins contraignante que les mois de mai et juin :
« Le plus dur, c’est le port du masque obligatoire pour les enseignants. C’est difficile par exemple de montrer le positionnement de la bouche pour la phonologie. Sinon, on a organisé des plannings pour que les enfants ne soient pas accueillis au même moment selon leur section. Il faut faire en sorte qu’ils se lavent les mains régulièrement au gel hydroalcoolique. Nous faisons le maximum mais il y a des mesures qu’on ne peut pas respecter à la lettre, alors on bricole pour que ça soit le mieux possible. La plus grande inquiétude pour les parents, quand on discute avec eux, c’est qu’il y ait un nouveau confinement. L’école à la maison a été difficile pour beaucoup. »
Plus globalement, elle confie que son activité est avant tout, une vocation :
« Je viens d’un milieu ouvrier. Petite, je ne partais pas en vacances. L’école m’a permis de découvrir énormément de choses, de m’ouvrir sur le monde… J’étais heureuse en y allant le matin. Rapidement, j’ai eu envie de transmettre cela, la joie que j’ai pu ressentir. Je suis donc devenue institutrice. Je me suis dirigée vers une école rep+ parce que c’est aux enfants des milieux modestes, comme moi, que je veux transmettre. C’est cela dont je rêvais quand j’étais petite. »

« Pour certains, c’est la peur au ventre tous les matins »
Mais « la réalité n’est pas aussi facile » raconte Caroline. « C’est possible de se faire bouffer par son métier en tant qu’enseignant. Personnellement, j’adore ce que je fais, j’ai un bon contact avec les élèves. J’ai toujours fait en sorte d’être sincèrement à leur écoute et bienveillante. C’est notamment grâce à ça que je vis bien mon métier. Mais j’ai déjà vu des collègues en situation de très grande difficulté, avec la peur au ventre tous les jours en allant à l’école. C’est terrible ça.«
Le lien avec la hiérarchie « peut-être très difficile aussi » selon elle. « Quand on veut le meilleur pour les enfants, et que des règles ou des programmes qu’on juge inadéquats sont imposés, c’est rageant. On peut ressentir une forme de perte de sens dans notre activité. L’emprise sur ce qu’on fait peut commencer au niveau de l’établissement, et elle va jusqu’au rectorat et au ministère. On n’est pas libre dans notre pratique. » Caroline explique que « les décisions prises sont souvent déconnectées de la réalité, et qu’il faudrait plus se baser sur les volontés des élèves : »
« Quand tu choisis ce boulot, souvent c’est que tu aimes l’école, mais c’est loin d’être le cas de tout le monde. C’est parfois presque impossible pour des enfants qui viennent de milieux non privilégiés de se projeter dans cette société et donc de s’investir à l’école. » Elle ajoute en riant que « le projet professionnel le plus répandu dans sa classe, c’est footballeur. »
« L’uniformisation demandée est un vrai drame »
Caroline explique qu’en théorie, « l’éducation nationale demande que les enseignants adaptent leur pédagogie à chaque élève, mais que dans la pratique, c’est impossible vu les effectifs des classes.« Selon elle, en France, une certaine uniformisation est demandée, et « c’est un vrai drame » : « Cette culture du bon élève est nocive. Les enfants doivent rentrer dans un moule. Ce sont des choses bien spécifiques qui sont valorisées, comme le français, la lecture ou les maths. Bien sûr, c’est important, mais il n’y a pas que ça ! Certains sont de grands bricoleurs, d’autres de grands dessinateurs, mais leurs qualités ne sont jamais reconnues. C’est leur vie entière qui peut être impactée par ça. »
En évoquant l’utilisation de formes de pédagogie alternative dans l’école publique, qui prennent plus les particularités des enfants en compte, Caroline est plutôt enthousiaste. « J’ai des amis qui ont déjà mis ça en place. C’était vraiment une réussite. » Mais cela nécessite des heures de formation, du matériel, et elle n’a jamais eu l’occasion de s’y atteler. « C’est à moi de faire toute la démarche, de me former à mes frais… »

Beaucoup d’investissement, peu de valorisation
Et pour cause, elle est déjà extrêmement occupée : « Tous les matins, je suis dans ma classe dés 7h30, et j’en ressort à 17h, avec une pause de seulement 30 minutes pour manger. Si je n’ai pas de réunion dans la foulée, j’ai encore en moyenne une heure de correction chez moi le soir. Je passe aussi en général 4h le mercredi après-midi et 4h le samedi à préparer les cours. Certes, nous avons les vacances scolaires, mais nous devons beaucoup travailler pendant celles-ci. Et c’est pris en compte dans nos salaires, par rapport aux autres fonctionnaires de catégorie A (recrutés à Bac+3 minimum), nos payes sont inférieures. »
En fin de carrière, tous les mois, l’institutrice gagne 2820 euros brut, plus une prime de 380 euros parce qu’elle enseigne en rep+, ainsi que 78 euros d’ISAE que touchent tous les enseignants. La nouvelle réforme des retraites, pour le moment repoussée par le gouvernement, fait angoisser Caroline. En début de carrière, pour un temps plein, elle touchait 4922 francs par mois, soit environ 750 euros. « Si la réforme passe, mon salaire de début de carrière sera pris en compte dans le calcul de la pension, alors que jusqu’à maintenant, ça n’était que les 6 derniers mois de la carrière. »

« On a une sacrée responsabilité quand même »
« J’ai fais le calcul. Si j’étais partie à la retraite à 45 ans, donc en 2011, avant que la réforme de Sarkozy ne soit effective, j’aurais eu 1100 euros de retraite. Maintenant, si je pars à 57 ans, ce qui correspond à l’âge légal pour le statut des anciens instits, j’aurais 1000 euros de retraite. Je vais devoir partir bien plus tard pour avoir une pension décente. » Même si son métier la passionne, qu’elle a de bonnes relations avec les élèves et les parents, Caroline se sent fatiguée. « On a une sacrée responsabilité quand même… c’était plus reconnu quand j’ai commencé. C’est vraiment ça qu’on demande… de la reconnaissance. Comme beaucoup de corps de métiers, on n’est pas les seuls. »
Pour finir, Caroline veut insister sur le fait que sa profession « reste indispensable et qu’elle a encore des aspects magnifiques » :
« Tout le monde passe par l’éducation nationale, et ça serait possible d’en faire quelque chose de vraiment émancipateur, en prenant plus en compte les particularités, les différences entre les élèves. Moi j’essaye de le faire, avec les moyens du bord. Le plus beau, c’est quand j’ai des retours des enfants, là je me reconnecte avec ce pourquoi je fais ce métier. »