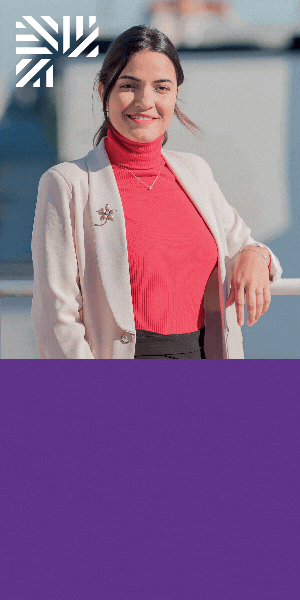Pour certaines, la rue n’est qu’un endroit de passage, pire, un passage obligatoire qu’on aimerait bien pouvoir éviter à des moments. Pour les traceuses, la rue est un lieu de vie. À toute heure du jour et de la nuit, dans n’importe quel quartier, ces pratiquantes du Parkour se réapproprient un espace souvent dominé par les hommes. Nous avons fait la rencontre de Math* (28 ans), Anouk (24 ans) et Stéphanie (33 ans), trois Strasbourgeoises qui vivent la rue à travers cette discipline.
Popularisé au début des années 2000, à la sortie du film « Yamakasi », le Parkour est une course qui se pratique en pleine ville, au cours de laquelle il faut franchir les obstacles qui se présentent sur son passage. Saut, escalade et un soupçon d’adrénaline : pour grimper sur le mobilier urbain, les murs, et parfois même les toits, mieux vaut avoir le cœur bien accroché.
S’il a vu le jour en banlieue parisienne, grâce à son créateur David Belle, il a su faire son nid à l’international et dans toutes les grandes villes françaises. À Strasbourg, le sport des Yamakasi séduit également. PkStras est l’unique association de Parkour de la ville. Il n’est donc pas rare de croiser des traceurs et des traceuses se dégourdir les jambes et les bras au Musée d’Art Moderne et Contemporain, sur le campus central, au niveau de la mairie de Schiltigheim et au Parkour park à Hautepierre.

Parce qu’elle est plutôt marginale, la discipline reste peu connue du grand public. Le commun des mortels peut s’imaginer des ninjas sautant de toit en toit et enchaînant les saltos. Cependant, pour chacune des traceuses rencontrées : ce sont des préjugés.
Alors, oui, la performance et les sauts spectaculaires que l’on peut voir en ligne ont bien leur place dans le Parkour. Cependant, Stéphanie explique que « ce n’est pas que ça » et que ça dépend du profil. Certain(e)s recherchent la performance et le « challenge », d’autres « une logique de partage » et quelques un(e)s « vont même partir dans des choses plus artistiques ».
Il y a donc autant de façons de pratiquer le Parkour qu’il y a de personnes. « C’est un art du mouvement qui peut se pratiquer partout et se décliner sous plein de formes. » résume Anouk de son côté. Math, qui aime explorer la ville grâce aux mouvements de Parkour, y voit surtout un aspect « utilitaire et social ». Le social, c’est toute la partie autour de la communauté de traceurs et de traceuses, qui peut prendre une place importante dans leur pratique et qui peut être un plus pour toutes les personnes désireuses de se lancer.


Sauter le pas
Sauter le pas, littéralement, n’est pas une mince affaire. En dehors des préjugés sur la discipline, il y a encore quelques années, ce sport ne réservait pas un très bon accueil aux femmes et véhiculait beaucoup de clichés sexistes. Anouk en a fait les frais. À 16 ans, elle découvre le Parkour dans le magasine Phosphore. « Je m’étais dit que je ne pourrais jamais faire ça, parce qu’à l’époque, il n’y a que des hommes dans le Parkour. ».
En plus du manque de représentation, la lycéenne devenue orthophoniste doit faire face à la réticence de son entourage et des autres traceurs qui voient d’un mauvais œil une fille qui s’adonne à un sport considéré comme dangereux. Elle raconte : « Les gars traçaient pas avec moi. Au tout début, on me disait que ce n’était pas un truc pour les filles et j’ai beaucoup tracé toute seule et avec ma sœur. »

Des années plus tard, grâce à leur persévérance, les traceuses se sont fait une place dans la discipline. Tout comme elles, de plus en plus de femmes s’y mettent, bien que leur nombre n’atteigne pas encore la parité. Les raisons sont multiples : la rue reste encore un espace anxiogène pour les femmes et les préjugés étiquetant le Parkour comme un sport dangereux ou spectaculaire persistent.
Les associations trouvent donc une parade pour attirer plus de femmes : les cours en non-mixité. Une initiative lancée en 2010 au sein de l’association parisienne Pink Parkour qui réserve tous ses cours aux femmes. L’idée est de leur permettre de s’entraîner ensemble afin de les mettre en confiance. En 2018, l’association de Strasbourg reprend l’initiative, c’est même Anouk qui devient l’une des deux coachs du créneau. Après une session d’essai qui séduit, Stéphanie et Math rejoignent le dit créneau, ainsi que quelques autres.
La réappropriation de la rue se met en place. En dehors des cours, elles se retrouvent souvent entre « meufs » pour tracer sur les « spots » (désigne les endroits où elles pratiquent le Parkour) découverts lors des cours ; sono allumée, qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige (mais pas trop).


Tracer entre femmes ou avec les hommes ? Pour Stéphanie, peu importe. La trentenaire qui ne s’est « jamais considérée comme une nana qui fait du Parkour » a rejoint ce créneau surtout pour la praticité par rapport à ses disponibilités et l’ambiance du cours d’essai qui lui a plu. « J’ai des rapports aux autres, que ce soit nanas, garçons, autres genres, tout à fait fluides. Pour moi, ce qui fait sens, c’est d’être ensemble et qu’on s’entraide ensemble. » dit-elle.
Math ne voit pas les choses du même œil. A l’inverse, elle aurait réfléchi à deux fois avant de rejoindre l’association s’il n’y avait pas eu de cours pour femmes. Selon elle, quand elle trace avec d’autres femmes, il y a beaucoup de coopération et de bienveillance : « On se donnait la main si on en avait besoin. On était toute derrière les unes les autres en disant ‘ouais, tu peux y arriver, tu peux le faire’ ». Ce qu’elle trouve peu présent avec les hommes : « Les mecs, ils te regardent juste et disent ‘vas y, fais ton truc’. Il y a moins de coopération, après évidemment si tu leur dis que tu as besoin d’aide, ils t’aident ».
Anouk, avec le recul des années, témoigne de la pertinence de la non-mixité pour se familiariser avec la rue, mais met en garde contre le faux sentiment de sécurité que cela procure sur le long terme. « À un moment, il faut se mélanger. » car selon elle, le but du Parkour est de « montrer qu’on est à l’aise, peu importe l’environnement. ».

Dompter sa peur et se réapproprier l’espace public
Montrer qu’on est à l’aise dans la rue n’est pas évident, surtout s’il faut en plus sauter, marcher à quatre pattes sur un kilomètre, rouler et escalader le mobilier urbain sans s’étaler, les quatre fers en l’air, sur le pavé. Ça demande du temps, de la persévérance et une dose de courage. Mais, à en croire ces traceuses, cet investissement vaut le coup : il suffit de voir tous les bénéfices qu’apporte cette discipline.
Et, heureusement, pas besoin de se jeter dans le vide pour les récolter, bien au contraire. Stéphanie, qui a récemment passé son brevet fédéral de Parkour, explique la marche à suivre : « Avant de faire des gros sauts, tu vas travailler petit et tu vas sentir un petit peu ta zone de progression qui s’élargit et tu vas sentir que tu débloques des trucs au fur et à mesure ». Dans le jargon, on dit « déblocage », c’est à dire réussir à faire un mouvement qu’on ne se sentait pas capable de faire avant, un peu comme sortir de sa zone de confort.
Dans un esprit de coopération, il est courant, de se faire des « parades » entre traceurs et traceuses. Une ou plusieurs personnes se placent à côté de l’obstacle pour éviter toute mauvaise chute et ainsi, mettre en confiance dans le déblocage. D’où l’importance d’un groupe où on se sent à l’aise. « Et du coup, tu sais que si tu rencontres une peur, tu vas pouvoir petit à petit la travailler, la débloquer et ça marche dans tout, pas que dans le Parkour. ». C’est cet exercice qui va permettre à la traceuse de connaître ses capacités et ses limites, tout en ouvrant son champ des possibles.



Un autre bénéfice important est la capacité à gérer le regard des autres. En choisissant ce sport, les traceuses ne doivent pas seulement faire face à elles-mêmes, elles doivent affronter l’intérêt des passant(e)s et badauds. « Je n’aime pas trop faire du Parkour quand il y a plein de monde, parce que tu es souvent accostée. ». Pour cette raison Math préfère tracer dans des lieux isolés. Stéphanie confirme qu’au début, elle cherchait également à fuir ce regard, « J’avais peur qu’on m’alpague et puis ce n’est pas facile de galérer devant les gens ».
Or, après avoir vécu plusieurs situations similaires, la fameuse zone de confort s’élargit. Math s’autorise à explorer la ville malgré la possibilité de se faire chasser des lieux et Stéphanie relativise si elle fait une mauvaise rencontre. « Quand t’as une personne qui dit : ‘pourquoi vous faites ça ? Faut vraiment être cramé. Moi, je ne ferai jamais ça.’ c’est vrai qu’il faut l’enquiller. Ce n’est pas grave en fait, tu laisses passer. Tu sais que tu es en train de te construire et puis, tu kiffes ton moment. ».
Peut-être plus probant encore est la situation d’Anouk qui témoigne avoir été la cible de harcèlement dans son adolescence. La conséquence a été une perte de confiance en les autres et le sentiment d’être en « décalage ». Après huit années de pratique, elle nous dit que ça l’a « sauvée ». « Ça m’a fait prendre confiance. J’ai appris à minimiser l’importance du regard des autres. ».

Une fois certains automatismes de Parkour acquis, un changement s’opère dans le regard des traceuses, elles ont l’Œil. Cet œil transforme chaque parcelle de béton en un terrain de jeu ou en un moyen d’atteindre un autre endroit. « Quand tu te déplaces dans la rue, finalement des lieux que tu connaissais très bien, tu vas la regarder sous un autre angle », nous dit Stéphanie en nous expliquant ce qu’est l’œil du traceur.
Ce regard différent vient d’une connaissance accrue de l’environnement et donne à la traceuse un sentiment de familiarité. « Tu subis plus l’environnement, mais tu joues avec, tu le vois différemment. » confirme Anouk. En fonction de leurs envies, les traceuses vont là où se trouvent les spots ; seule ou accompagnée ; de jour comme de nuit.
Quid du sentiment d’insécurité dans la rue ? Math explique que si jamais une situation arrive où elle se sent en danger, elle sait comment réagir, car elle connaît ses capacités « Je sais qu’il y a du mobilier, il y a tel mur, je peux les grimper. ». Anouk préconise de « transformer son propre regard » et « apprendre à dialoguer avec les gens qui te font peur » quand c’est possible. Elle indique, ainsi, ne « jamais se sentir menacée dans la rue » même à 23 h. « Avoir un autre regard, ça me protège » conclut-elle.
*Le prénom a été modifié.
Fanny J. Babouram