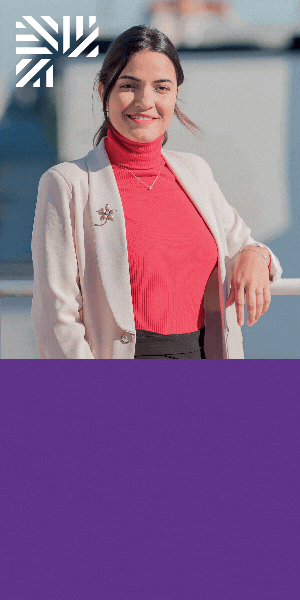Le 9 août, Robert fêtait ses 90 ans dans la maison qui l’a vu grandir à Oberhoffen-sur-Moder, une commune bas-rhinoise située à une trentaine de kilomètres au nord de Strasbourg.
Dans la grange qui sépare la maison du jardin, juste à côté des cages à lapins, une table a été installée pour l’occasion. Au-dessus flotte une ribambelle de ballons colorés et tout autour, on retrouve la famille au complet (ou presque). Il y a bien sûr Marguerite, 88 ans, mariée à Robert depuis 66 ans ; leur fils unique Richard et sa compagne Marie-Paule, rejointe par deux de ses frères car dans la famille Jung, les mariages unissent les époux comme les familles. Il y a aussi leurs deux petits-enfants, Cindy, son mari Sébastien et leurs deux filles, et Guillaume, accompagné de moi-même, l’humaine au bout des doigts qui tapent sur le clavier…
En tout, ce sont quatre générations en santé qui taillent le bout de gras à l’ombre du corps de ferme dont les briques rouges reflètent le coucher du soleil. Une situation inédite pour moi, issue d’une famille qui n’est pas très famille. Et l’occasion pour la première fois de faire appel au vécu des anciens afin de mieux comprendre et orienter mon destin. Nés en 1930 et 1928, Marguerite et Robert sont des enfants de l’entre-deux-guerres ; ils avaient 9 et 11 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, 15 et 17 ans lorsqu’elle a pris fin. Aujourd’hui, ils sont à la tête d’une chaîne d’amour qui s’étend jusque trois générations après eux, et qui évolue dans un monde très différent de celui que le couple de paysans a connu — ne serait-ce que technologiquement. Je me suis dit qu’ils avaient forcément quelques clés sur l’Alsace et la vie, et que les deux pourraient nous servir à nous autres, « la jeunesse » comme dit Robert. Rencontre avec papi et mamie.

Vous aviez 9 et 11 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté : c’était comment, la vie entre deux guerres ? Grave et tendu ou, en tant qu’enfant, quand même un peu insouciant ?
Robert : Nos parents avaient déjà vécu la guerre donc on avait déjà peur. Et dès 1937, la plupart d’entre nous savait qu’il y allait en avoir une nouvelle : il y a eu le chômage, et on voyait les familles juives partir. Quand j’avais dix ans, en me voyant partir à l’école avec mon cabas de livres, le sac de catéchisme et le masque à gaz au cas où, mon père m’a dit : « Il ne te manque que le fusil et tu es déjà un petit soldat. »
Marguerite : C’était une enfance très différente de maintenant. On travaillait déjà dans les champs ou à la maison très jeunes.
Robert : C’était parfois très très dur, et c’est pour ça que je suis foutu. Il fallait travailler trop dur dans la jeunesse, surtout dans les familles paysannes. Je me rappelle d’une fois en 1938, j’avais dix ans, et mon père m’a dit : « Tu as bien aidé. Cet après-midi, tu peux aller te baigner dans la Moder. » — c’est la rivière qui passe ici. J’étais content, j’allais être avec les autres enfants qui s’y baignaient tous les après-midis. À peine dans l’eau ma mère vient me chercher, papa avait glissé dans l’escalier et s’était fait une double fracture de la cheville. Il allait avoir un plâtre et avant de partir, il m’a dit de m’occuper des champs l’été. Finie la baignade ! L’automne, c’est aussi moi qui ai guidé le cheval pour bien labourer les terres.
1939, la guerre éclate : qu’est-ce qui change dans vos vies de français ? Et d’alsaciens ?
Robert : Dans les familles, tout est resté assez normal… C’est quand on a changé de nationalité, en juin 1940, que c’est devenu compliqué. Plein de choses ont été interdites : porter le béret, parler le français. On avait eu des cours d’allemand en primaire et puis notre patois, l’alsacien, est presque allemand donc on se débrouillait. La nourriture était rationnée aussi, on avait des timbres.
Marguerite : Une fois j’ai perdu les timbres de la famille en bataille avec un garçon (nda, un garçon lui a volé ses timbres). Ça c’était terrible, on ne pouvait pas manger jusqu’aux prochains…
Robert : Moi ma famille n’avait pas de timbres parce qu’on était paysans : on devait être autosuffisants, en tout cas pour l’essentiel… Alors on cultivait le blé, on allait le moudre au moulin et on rentrait avec de la farine pour faire le pain. Et pour la viande, on élevait des cochons. Selon le nombre de kilos de viande que la bête donnait, on était privés de tickets pendant un ou deux mois et il fallait se débrouiller !

Robert, vous avez eu 16 ans en 1944 : vous avez donc été appelé à rejoindre l’armée allemande…
Robert : Oui. Dès 16 ans quand on était encore allemands, il fallait passer le conseil de révision chez un médecin qui décidait si on intégrait le service armé ou si on était réformé. Mes copains ont été envoyé à la frontière entre l’Allemagne et la Pologne ; aucun n’a péri. Moi et un ami, on a été ajourné six semaines parce qu’on travaillait dans l’exploitation de ses parents et sur la fin de ces six semaines les troupes ont libéré la France. J’ai eu de la chance de travailler la terre. Mais c’est là que la situation a empiré dans les villages. Sur la fin Hitler a commandé les pires saloperies pour faire plein de dégâts avant d’être stoppé. Juste pour faire du mal.
Marguerite : Dans la guerre, seule avec ma mère, j’avais peur… Quand les américains venaient, on était américaines. Quand les allemands venaient, on était allemandes. À 14 ans, ma mère et moi on a eu peur des soldats américains qui venaient chez nous, j’étais une jeune fille. On est allés voir la mère de Robert pour qu’il vienne dormir à la maison pour nous rassurer. C’est comme ça qu’on s’est connus, mais on ne s’est pas *connus* ce soir-là hein ! [rires]
Robert : Fin 1944, quand les américains ont fui, c’était le signal que les allemands allaient revenir. Cette fois-ci la guerre est venue jusqu’à Oberhoffen-sur-Moder. J’ai fui avec mon père près de Saverne où on avait de la famille et elle avec sa mère à Bischwiller. On y est restés jusqu’à la Pentecôte… Quand on est rentrés en 1945, tout était détruit.
Comment se réorganise la vie au sortir de la guerre ? Est-ce que vous craignez encore la guerre ? Quid du service militaire français après avoir subi la guerre ?
Robert : Quand, comme mes parents, vous avez travaillé toute votre vie pour rentrer dans votre maison entièrement détruite… On était pauvres, effrayés et très déprimés, il fallait tout recommencer à zéro. Le gouvernement nous a logé dans des baraques en bois, parce que ça allait vite. On recevait une baraque et puis il fallait tout racheter et tout reconstruire sur une vingtaine d’années. Ça a rythmé nos vies, c’est sûr. Par contre on n’a jamais pensé qu’il pourrait y avoir une nouvelle guerre, ça non. On avait confiance en De Gaulle et Adenauer pour la réconciliation — même plus en l’Allemand dans le temps… Aujourd’hui on ne craint plus la guerre mais on n’aime toujours pas le gouvernement ! [rires] Le 1er décembre 1948, je rentre dans l’armée française pour faire mon service militaire… J’étais aigri par la reconstruction alors j’ai choisi de m’engager. Comme j’aimais beaucoup les chevaux j’ai intégré un service dans les colonies, au Maroc, avec des chevaux arabes. Je me souviens avoir traversé le Détroit de Gibraltar au petit matin, face à Tanger illuminée — pas mal hein, pour un petit paysan alsacien ? [rires] Ça a duré un an et puis la guerre d’Indochine s’est intensifiée et je suis rentré, même si j’étais déprimé de tout refaire… Mais, bon, mon père avait plus de 70 ans, ce n’était plus à lui de faire.

En 1952 vous vous marriez et en 1956 vous avez un fils, votre seul enfant : c’était difficile, d’avoir un enfant dans un monde sans guerre, de fait très éloigné de celui que vous avez connu enfants ?
Marguerite : Ah ça, on n’a pas eu la même enfance, c’est sûr.
Robert : On s’est mariés en 1952 et puis on s’est dit, pour les enfants, on a encore le temps. On bossait dur sur la maison et puis il y avait une expression : « A bueh egàl canonfleish. » Un garçon égal de la chair à canon. C’est pour ça, on n’était pas pressés d’avoir un enfant. Mais bon il faut bien se reproduire hein, alors en 1956 on a eu Richard. Et un seul enfant c’était déjà une chance. La tante de Marguerite en a eu quatre et elle en a perdu quatre, donc un en santé ça suffisait. L’enfance de Richard, c’est sûr, c’était un autre monde.
Marguerite : Un tout autre monde…
Robert : C’est 100% différent. Parfois on disait : « On a ceci ou cela à faire ! » Et Richard il répondait : « Ah non je n’ai pas le temps, il y a ma série à la télé chez Mamie. » [rires] Nous on aime le travail, parce qu’on n’a pas connu autre chose. Tous les jours on était avec les bêtes, dans les champs, ou à la cuisine. À 14 ans une vache a vêlé le soir de Noël : fini Noël. On est allés s’en occuper… Pour ça, c’était difficile de se comprendre parfois. En même temps moi, j’espère toujours que la jeunesse, ça leur va mieux qu’à nous. Parce que ce qu’on a supporté, il fallait le supporter quand même. Et je ne leur souhaite pas.
En plus du quotidien, il y a eu le progrès technologique. Comment vous l’avez vécu, vous qui êtes nés dans un monde où on s’apprêtait tout juste à inventer la télévision ?
Robert : On a vécu ça progressivement, très progressivement. D’abord il y a eu le téléphone, et puis il y a eu la télévision. Ma mère en avait une et en 1974, on a vu l’Allemagne devenir championne du monde ! Du coup en 1978, on a acheté un poste parce que c’était au Mexique, et avec le décalage horaire, on ne pouvait pas venir à huit heures du matin chez mamie.
Marguerite : C’est pour ça qu’on a eu la télé : à cause du foot ! [rires] Par contre, le téléphone portable, I’ordinateur, tout ça c’était trop, on n’a pas réussi à suivre.
Vous avez supporté l’équipe allemande, vous avez vendu des chiens en Allemagne (nda : en 1963 la maison de Marguerite et Robert brûle et tout est à refaire une deuxième fois. Paysans, ils n’ont pas de chômage. Ils travaillent donc à l’hospice en tant qu’aide-soignante et que fermier et, pour tout loisir, élèvent des bergers allemands, qu’ils vendent souvent de l’autre côté de la frontière) : la haine de l’Allemand, c’est une légende alors ?
Marguerite : Oh non.
Robert : Il y a une haine qui reste… Je vais être honnête, je peux pas les supporter. Il y a des innocents, bien sûr, je me souviens d’un soldat allemand qui a gentiment rappelé à ma mère qu’elle ne pouvait plus dire « au revoir » en français. Elle le disait tout le temps par habitude. Il aurait pu la battre ou l’arrêter, et il a choisi de lui donner une chance. Je crois que les Français ne nous ont jamais compris. Entre le patois, l’annexion, les malgré-nous, ils nous regardaient comme des boches ; ils nous traitaient à l’armée. C’est de là que vient la haine je pense : les allemands nous ont volé notre identité de français… Enfin, tout ça, c’est la politique.
Durant l’entretien Marguerite, que je connais mordante dans l’expression, est restée assez silencieuse. Les garçons partis chercher un livre d’archives sur le village elle me confie qu’en tant que fille unique et comparé à son mari paysan, elle a le sentiment d’avoir eu « la guerre facile » à la maison. Et ce malgré la menace de viol que représentaient les soldats de passage, qu’il fallait nourrir tant bien que mal en dépit du rationnement… Comme des millions de femmes durant la Seconde Guerre mondiale Marguerite a participé à l’effort collectif, et elle l’ignore encore.